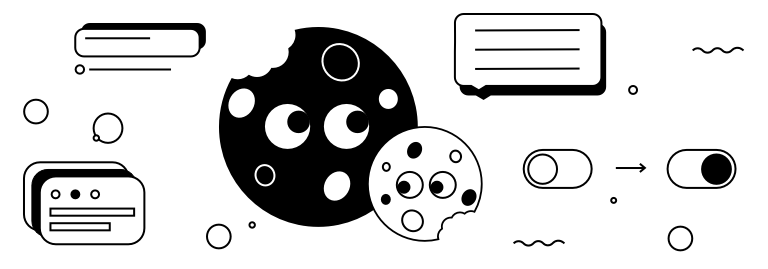Le 28 juin 2025 s’annonce comme une date charnière dans le déploiement de la Directive européenne 2019/882, qui vise à transformer le paysage de l’accessibilité numérique en Europe, et notamment en France. Au-delà d’une simple mise en conformité juridique, l’enjeu est éthique et sociétal : garantir que produits et services numériques soient véritablement accessibles à tous, avec une priorité accordée aux personnes en situation de handicap. Pour appréhender pleinement les défis et opportunités à venir, il est essentiel de cerner le cadre législatif qui structure cette échéance. Une exploration de son contexte, axée sur les fondements législatifs et les enjeux sous-jacents, permet de comprendre comment les entreprises devront adapter leurs stratégies et obligations. Cette date du 28 juin, en tant qu’étape significative, souligne l’impératif d’une mobilisation collective pour concrétiser cette vision d’inclusion. La compréhension du cadre législatif devient alors primordiale, en amont de toute exploration des défis et opportunités qui se présentent.
1. Comprendre l’accessibilité numérique et son cadre européen.
1.1 : Qu’est-ce que l’accessibilité numérique et pourquoi est-elle essentielle dans notre société ?
L’Accessibilité numérique désigne la capacité d’un environnement numérique – qu’il s’agisse d’un site web, d’une application mobile, d’un logiciel ou de tout autre dispositif digital – à être utilisé par tous les individus, y compris les personnes en situation de handicap. Cette notion rejoint la vision de Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, qui définit l’accessibilité comme l’acte de « mettre le Web et ses services, à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique, ou leurs aptitudes physiques ou mentales ».
Dans un monde où le numérique est omniprésent, de la communication à l’éducation, en passant par les services publics et le commerce, l’accessibilité numérique n’est pas un simple ajout, mais un impératif fondamental. Elle garantit que chacun, quelles que soient ses limitations physiques, sensorielles, cognitives ou techniques, puisse accéder à l’information, interagir avec les interfaces et participer pleinement à la société numérique. Au-delà d’une obligation légale, l’accessibilité numérique représente un enjeu majeur d’inclusion, d’égalité des droits et d’autonomie, permettant à tous de bénéficier des opportunités offertes par le numérique.
1.2 : Pourquoi la directive européenne 2019/882 marque-t-elle un tournant dans l’harmonisation de l’accessibilité numérique en Europe ?
La Directive européenne 2019/882, également connue sous le nom d’Acte européen sur l’accessibilité, représente un jalon majeur dans l’harmonisation des normes d’accessibilité à travers l’Union européenne.
Adoptée le 17 avril 2019, cette directive vise à éliminer les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap lors de l’utilisation de produits et services essentiels. Son objectif principal est de garantir que ces produits et services soient accessibles de manière uniforme sur le marché intérieur, facilitant ainsi la libre circulation et promouvant l’inclusion.
Elle couvre un large éventail de domaines, allant des distributeurs automatiques et des terminaux en libre-service aux services bancaires, en passant par le commerce électronique et les livres numériques.
En imposant des exigences d’accessibilité communes, la directive vise à créer un environnement numérique plus inclusif pour tous les citoyens européens.
1.3 : Comment les normes WCAG, EN 301 549 et RGAA s’articulent-elles pour assurer l’accessibilité numérique en France et en Europe ?
Les normes de référence qui encadrent l’accessibilité numérique des sites web sont les WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Elles sont élaborées par la WAI (Web Accessibility Initiative), une branche du W3C (World Wide Web Consortium). Depuis leur première publication en 1999, les Web Content Accessibility Guidelines ont évolué, la version actuelle étant la WCAG 2.2. Il est important de noter que les WCAG 2.0 ont été adoptées comme norme ISO sous la référence ISO/IEC 40500:2012, tandis que la version 2.2 est actuellement en cours d’évaluation.
Au niveau européen, la norme EN 301 549 est une norme qui définit les exigences d’accessibilité applicables aux produits et services numériques, y compris les sites web mais pas uniquement. Cette norme est utilisée comme référence technique dans la Directive 2019/882, (Acte européen sur l’accessibilité), qui harmonise les exigences d’accessibilité au sein de l’Union Européenne. La norme EN 301 549 s’appuie en partie sur les WCAG 2.1 lorsqu’elle traite des sites Internet. Elle assure ainsi une cohérence entre les recommandations techniques et les obligations légales.
En France, le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité RGAA fournit un cadre d’application technique et pratique adapté au contexte légal et administratif français. Il sert de référence pour s’assurer de la conformité des sites web aux exigences d’accessibilité numérique. Le RGAA s’aligne en partie sur les WCAG 2.1, mais présente des différences notables avec la norme EN 301 549. En effet, le champ d’application de l’Acte européen sur l’accessibilité est plus vaste que celui du RGAA. Il couvre par exemple les logiciels de visioconférence, tandis que le RGAA est surtout dédié aux sites web. Enfin, certaines exigences de l’Acte européen peuvent être plus strictes que celles du RGAA.
Il faut comprendre ces nuances pour assurer une conformité adéquate aux exigences d’accessibilité à la fois en France et en Europe. Le RGAA peut être considéré comme un point de départ pour les organisations françaises, mais il est important de se référer à la norme EN 301 549 lorsque l’on souhaite atteindre un niveau de conformité complet. En effet, la norme européenne propose un cadre d’harmonisation pour l’accessibilité numérique qui dépasse le seul domaine du web, alors que le RGAA, dans sa version 4 actuelle, qui prend en compte les WCAG 2.1, se limite aux sites Internet.
2. Les enjeux de la conformité pour les sites web et applications mobiles à l’approche du 28 juin 2025.
2.1. Quelles sont les conséquences en France de la transposition de la directive européenne pour les sites web et applications mobiles ?
La France a entrepris un long processus de normalisation des sites Internet qui remonte aux années Jospin. En 1999, la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a marqué une étape importante en affirmant le droit d’accès de tous aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cette prise de conscience de l’importance croissante du numérique a conduit le gouvernement à initier des réflexions sur la manière de rendre les services en ligne accessibles à tous. C’est dans ce contexte qu’ont émergé les premières versions du Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations, initialement conçu pour encadrer l’accessibilité des sites web du service public.
Ces premières versions du RGAA, antérieures à l’établissement des normes européennes harmonisées, traduisaient une volonté de garantir que les services publics numériques soient accessibles à tous les citoyens, y compris les personnes en situation de handicap. Au fil des années, ce processus s’est intensifié. Une étape marquante fut la publication, le 25 septembre 2019, de la version 4 du RGAA, qui a marqué une évolution significative. Ce référentiel est devenu le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité, élargissant ainsi son champ d’application.
Cette évolution a eu des conséquences importantes pour les entreprises du secteur privé, qui se sont vues progressivement soumises aux mêmes exigences d’accessibilité que les administrations publiques. Cette extension du RGAA traduit une volonté d’harmoniser les pratiques en matière d’accessibilité numérique sur l’ensemble du territoire français, et d’assurer une inclusion numérique complète pour tous les utilisateurs. Parallèlement, la France a participé activement aux travaux menés au niveau européen, notamment dans le cadre de l’élaboration de la norme EN 301 549 et de la Directive 2019/882.
Afin de se conformer à la Directive 2019/882, la France a engagé un processus de transposition en droit national, qui consiste à adapter sa législation et à créer de nouveaux textes réglementaires. La norme européenne EN 301 549 a été transposée dans l’Hexagone, en particulier par le décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des produits et services. Ce processus vise à intégrer les exigences d’accessibilité définies par la directive dans le cadre juridique français.
Comme mentionné précédemment, cette nouvelle étape étend le champ d’application de la réglementation en matière d’accessibilité numérique au-delà des seuls sites Internet. En ce qui concerne ces derniers, elle abaisse néanmoins les seuils de conformité et précise les secteurs d’activité qui vont désormais devoir adapter l’ensemble de leurs services de communication en ligne.
La transposition de la directive en droit français renforce surtout les obligations des entreprises en matière d’accessibilité numérique, et précise les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-conformité. Les organismes publics sont quant à eux soumis à des obligations d’accessibilité numérique depuis plus longtemps, notamment en vertu de la loi du 11 février 2005.
2.2. Quels secteurs sont concernés par la transposition de la directive 2019/882 et quelles sont les implications pour leurs sites web et applications mobiles ?
La Directive européenne 2019/882, transposée en droit français, impose des exigences d’accessibilité à des secteurs économiques clefs. Concernant les sites web et applications mobiles, le secteur du e-commerce se trouve en première ligne. Les acteurs de la grande distribution, du commerce spécialisé (beauté, santé, habillement, équipement de la maison, sport…) sont particulièrement concernés. Ils devront garantir une expérience d’achat en ligne autonome pour les personnes en situation de handicap, incluant l’accès aux informations produits et l’utilisation de solutions de paiement accessibles.
Les services de transport de voyageurs constituent un autre secteur majeur. Leurs sites web et applications mobiles, ainsi que les services associés, doivent désormais être conformes aux exigences d’accessibilité.
Le secteur bancaire représente un troisième pilier. Bien que le décret de transposition ne mentionne pas explicitement les sites web et applications mobiles, la nature des services concernés (fiches d’information, contrats, services bancaires, paiement) et leur utilisation croissante via les applications, rend leur mise en conformité impérative.
La question des services de communication électronique mérite une attention particulière. Conformément au Code des postes et des communications électroniques, les services de communication interpersonnelle et interactive, lorsqu’ils constituent une fonction mineure accessoire d’un autre service, sont exclus du champ d’application. Cependant, il convient d’analyser chaque service au cas par cas pour déterminer son assujettissement.
Enfin, d’autres secteurs, tels que les médias audiovisuels, sont soumis à des obligations spécifiques afin de garantir un accès universel à l’information et aux services.
2.3. Dans quelle mesure le RGAA peut-il servir de point de départ pour mettre en conformité les sites web et applications mobiles concernées par l’échéance du 28 juin 2025 ?
La question de la période transitoire, prévue jusqu’au 28 juin 2030, suscite des interprétations divergentes. Afin de clarifier ce point, il est essentiel de se référer directement aux textes législatifs et réglementaires. L’article 3 du décret français d’application précise que : « Les dispositions de l’article 1er du présent décret sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023. »
Les modalités pertinentes de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 stipulent :
- « B.-Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date. »
- « C.-Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030. »
L’analyse conjointe de l’article 3 du décret et des clauses B et C de la loi permet de conclure que les obligations de conformité s’appliquent aux applications mobiles et sites web fournis après le 28 juin 2025.
Par conséquent, il convient de distinguer deux situations :
- Les acteurs déjà soumis au RGAA ont intérêt à anticiper la mise en conformité d’ici 2030, en intégrant les adaptations nécessaires ;
- Les projets lancés après 2025 devront être conçus dès l’origine en conformité avec la norme EN 301 549 et, le cas échéant, le RGAA.
Comme le précise le site dédié au RGAA, il faut noter que sa version 4.1 ne couvre pas les applications mobiles natives (ni les progiciels et le mobilier urbain numérique). Pour ces dernières, la conformité ne peut donc être vérifiée qu’en s’appuyant sur le standard européen EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) via une méthode par exemple inspirée du RAAM (Référentiel d’évaluation de l’accessibilité des applications mobiles) luxembourgeois.
Bien que le RGAA soit le standard de référence, on notera que rien n’interdit de se baser sur un autre cadre comme les WCAG 2.1 de niveau simple (A) et double (AA), ou la norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) le cas échéant, à condition de respecter le point IV de l’article 47 : la page d’accueil de tout service de communication au public en ligne doit indiquer clairement sa conformité ou non aux règles d’accessibilité. De plus, ces services doivent offrir un accès aisé et direct à la déclaration d’accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité, au plan d’actions de l’année en cours, et permettre aux usagers de signaler facilement les manquements aux règles d’accessibilité.
3. Anticiper les défis et les évolutions futures de l’accessibilité numérique.
3.1. Quels sont les défis de la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la directive 2019/882 ?
Bien que l’établissement d’un partenariat solide entre les diverses parties prenantes soit essentiel pour garantir la mise en œuvre de la Directive européenne 2019/882, il est important de reconnaître la complexité de cette collaboration. Les acteurs impliqués, qu’il s’agisse des pouvoirs publics qui transposent la directive dans le droit national, des entreprises qui conçoivent et fournissent les produits et services concernés, ou des organismes de formation et de conseil en accessibilité numérique, poursuivent des objectifs et font face à des contraintes qui ne convergent pas toujours.
Les pouvoirs publics, par exemple, doivent équilibrer l’impératif de protection des droits des personnes en situation de handicap avec les réalités économiques et administratives. De leur côté, les entreprises doivent concilier les exigences d’accessibilité avec les impératifs de compétitivité et d’innovation. Enfin, les organismes de formation et de conseil doivent adapter leurs offres aux besoins variés des entreprises, tout en assurant la qualité et la pertinence de leurs services.
Mais il faut surtout souligner que l’échéance du 28 juin 2025 confère aux organisations de personnes en situation de handicap un levier d’action considérablement élargi. Au-delà de leur rôle d’expertise et de sensibilisation, ces associations se trouvent désormais en position de revendiquer activement la conformité des sites web et applications mobiles auprès d’un éventail d’entreprises bien plus étendu qu’auparavant. En effet, si l’initiation de procédures judiciaires était déjà envisageable contre les organisations dont le chiffre d’affaires dépassait les deux cent cinquante millions d’euros, le 28 juin 2025 fait sauter cette limite, et ouvre la voie à des actions en justice potentielles contre une multitude de structures. Cette nouvelle donne pourrait même, à l’image de ce qui se pratique de longue date aux États-Unis, entraîner une augmentation significative des actions en justice à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas les normes d’accessibilité. Si cette perspective n’est pas nécessairement souhaitable, elle souligne néanmoins l’importance cruciale de se préparer à ces nouvelles exigences.
3.2 : Quels sont les impacts économiques et sociaux de l’accessibilité numérique, et pourquoi est-il crucial de l’intégrer dans les stratégies des entreprises ?
Si l’on mesure bien désormais l’apport essentiel de l’Accessibilité numérique sur le plan social, sur le plan économique, elle représente un levier de croissance. En élargissant l’audience potentielle des produits et services numériques, elle ouvre de nouveaux marchés et renforce la compétitivité des entreprises. Aujourd’hui prêt de 10 millions de français sont concernés de prés ou de loin par l’Accessibilité numérique. De plus, elle améliore l’expérience utilisateur pour tous, ce qui peut se traduire par une augmentation de la satisfaction client et une réduction des coûts liés au support. Enfin, sur le plan juridique, l’accessibilité numérique est de plus en plus encadrée par des obligations légales et réglementaires. Les entreprises qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à des risques de contentieux, à des sanctions financières et à des atteintes à leur réputation. L’accessibilité numérique est donc non seulement une question d’éthique et de responsabilité sociale, mais aussi un impératif légal et économique.
3.3 : Comment anticiper les évolutions futures de la réglementation et préparer une meilleure intégration des normes européennes dans le RGAA ?
La future version 5 du Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité est attendue avec impatience par les professionnels du numérique et les défenseurs de l’accessibilité. L’un des enjeux majeurs de cette mise à jour réside dans une meilleure intégration de la norme européenne EN 301 549. L’objectif est de réduire, voire de supprimer, la zone de chevauchement qui pourrait contraindre certaines organisations à effectuer deux déclarations de conformité distinctes.
Cette harmonisation est cruciale pour simplifier les démarches et encourager une adoption plus large des standards d’accessibilité. De plus, la version 5 du RGAA devrait entériner définitivement les conditions temporelles, apportant ainsi une clarté bienvenue pour les acteurs concernés. La période transitoire s’étendant jusqu’au 28 juin 2030 semble justifiée, compte tenu du taux de conformité actuel des sites web, estimé à moins de 1 % par certaines études.
Ce délai doit permettre aux organisations de s’adapter progressivement aux nouvelles exigences, sans compromettre l’objectif final d’un web plus inclusif. Il faut toutefois insister sur le fait que, désormais, les nouveaux projets web et mobiles doivent intégrer l’accessibilité numérique par défaut, selon le principe d’une « accessibility-by-design« . Cette approche proactive, qui intègre l’accessibilité dès la conception, est essentielle pour garantir la conformité des projets concernés. L’harmonisation avec la norme européenne et la clarification des échéances devraient contribuer à accélérer la mise en conformité.
Bien qu’elle ne constitue pas une révolution, l’échéance du 28 juin 2025 marque une étape cruciale pour l’accessibilité numérique en Europe et en France. Si le cadre normatif, dominé par la directive européenne 2019/882, est désormais plus clair, l’articulation entre les normes WCAG, EN 301 549 et RGAA reste complexe. Le RGAA, bien que pertinent, ne garantit pas systématiquement une conformité totale à la norme EN 301 549. La mise en conformité des sites et applications mobiles demeure un sujet prioritaire, qui exige une collaboration renforcée entre les acteurs et une intégration de l’accessibilité comme avantage concurrentiel dans les stratégies d’entreprise. Au-delà de l’harmonisation normative indispensable, il est d’ores et déjà impératif d’anticiper l’intégration des technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle et la réalité augmentée, dans les prochaines normes d’accessibilité, afin de garantir que ces innovations bénéficient à tous, sans exception.
Sources :
Olivier Keul et Aurélien Levy « Synthèse des nouvelles règlementations d’accessibilité numérique en France » in blog Temesis [23/10/23 mis à jour le 21 janvier 2025] (25/03/25) [https://www.temesis.com/blog/synthese-des-nouvelles-reglementations-encadrant-laccessibilite-numerique-en-france/]
Shawn Lawton Henry, traductions françaises de Rémi Bétin et Sylvie Duchateau « Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2 – Vue d’ensemble » in W3C [Juillet 2005 – dernière version révisée 12/12/24] (25/03/25) [https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/fr].
Lucie Séguier « L’accessibilité numérique » in lisio.fr [22/01/24] (25/03/25) [https://lisio.fr/blog/article/l-accessibilite-numerique].
Service information et presse du gouvernement luxembourgeois « Référentiel d’évaluation de l’accessibilité des applications mobiles (RAAM 1.1) » in Portail de l’Accessibilité numérique [24/02/25] (25/02/25) [https://accessibilite.public.lu/fr/raam1.1/index.html].
« Code des postes et des communications électroniques » in Légifrance [23/05/24] (25/03/25) [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006150658#LEGIARTI000033219763].
« Décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des produits et services » in Légifrance [11/10/23] (25/03/25) [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048178349].
« Directive (UE) 2019/882 du parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » in Journal officiel de l’Union Européenne [17/04/19] (25/03/25) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882#d1e2776-70-1].
Comité technique de l’ETSI et groupe de travail CEN/CENELEC/ETSI « Norme européenne harmonisée EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) – Exigences d’accessibilité pour les produits et services ICT » in Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité [version *.PDF d’août 2018] (24/03/25) [https://accessibilite.numerique.gouv.fr/doc/fr_301549v020102p.pdf].
« Code monétaire et financier » in Légifrance [version en vigueur depuis le 01/04/18] (25/03/25) [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731653].